LA SESS
LES ÉTUDES SOCIALES
TRAVAUX ET ACTUALITÉS
RESSOURCES
Figures
de la science sociale
A une lieue au levant de Honfleur, sur la rive gauche de la basse Seine, s’étend le gros village de la Rivière-Saint-Sauveur. C’est là que, le 11 avril 1806, naquit Pierre-Guillaume-Frédéric LE PLAY, fils de Pierre-Antoine Le Play et de Marie-Louise-Rosalie Auxilion. Son père occupait un modeste emploi dans l’administration des douanes.
" Mes premiers souvenirs, raconte celui dont je veux retracer la vie, me reportent à la détresse des pêcheurs dont l’industrie était ruinée par la flotte anglaise gardant l’embouchure de la Seine et toujours prête à jeter sur la côte ses marchandises de contrebande. Les vieux matelots se consolaient des humiliations du blocus par le souvenir de leurs exploits dans la guerre maritime qui prit fin en 1783; " et, passionné pour leurs récits, l’enfant s’initiait à l’amour du pays près de ces obscurs héros de notre Normandie.
En 1811, des devoirs de service séparèrent M. Le Play de sa famille, et l’une de ses soeurs se rendit à Honfleur avec son mari. Les deux époux n’avaient point d’enfant. Ils se prirent d’affection pour leur jeune neveu et l’emmenèrent à Paris, où ils lui firent donner la première instruction. Ils demeuraient rue de Grammont, no 15, dans une maison dont ils étaient propriétaires, et qui existe encore à peu près telle qu’ils l’habitaient. Le jeune Frédéric fut placé comme externe, rue de Grétry, dans une école qui ne lui laissa aucun bon souvenir. Il fit son éducation littéraire dans le salon de ses parents, où, tous les soirs, son oncle réunissait d’anciens condisciples qui, nés dans l’aisance, mais moins heureux que lui, se trouvaient, après les désastres de la Révolution, sans famille et sans fortune. L’attrait de ces réunions était entretenu par une table hospitalière , par une riche collection de livres formant la principale décoration du salon et surtout par d’incessantes causeries sur les lettres et les arts, sur les crimes de la Révolution, sur les gloires éclatantes, puis sur les poignantes tristesses de l’Empire. Dans un pareil milieu, l’esprit du jeune Frédéric acquit une précoce maturité. Il y puisa sur la littérature ancienne et sur l’histoire moderne de la France des opinions, qui furent d’abord momentanément effacées par les enseignements des écoles, mais qui plus tard reprirent leur juste influence à mesure qu’avançant dans la vie, il constata l’abaissement du pays et chercha le remède à sa décadence.
Devenue veuve en 1815, la tante de Frédéric le rendit à sa mère. Il revit Honfleur avec joie. Le luxe de l’appartement Louis XVI, qu’il habitait hors des heures d’école, ne lui avait point fait oublier les vergers et les rivages normands. La vie en plein air de la campagne n’avait que gagné au parallèle qu’il en avait pu faire avec l’existence sédentaire de la ville. Ses premières impressions d’enfance ne s’étaient effacées et ne s’effacèrent jamais. Que de fois je fus témoin du charme qu’exerçaient sur Le Play le spectacle de la nature et l’étude de ses merveilleux ouvrages!
De 1818 à 1822, Le Play suivit comme externe les classes d’humanités au collège du Havre. A sa sortie de rhétorique, il subit avec succès les épreuves du baccalauréat es lettres. L’année 1823 fut l’époque décisive de sa vie. Il avait de bonne heure compris qu’il devait tenir son avenir de lui seul, et, comme diversion à ses études, il avait puisé dans quelques livres des notions d’arithmétique et de géométrie. Édifié par sa petite science théorique, un arpenteur, qu’il rencontrait souvent dans les champs, lui enseigna l’usage des jalons et de l’équerre, puis lui proposa de le prendre pour associé et plus tard pour successeur. D’autre part, un ami de collège, qui se préparait à l’École polytechnique, l’engageait vivement à suivre la même direction. Ce conseil lui souriait; mais ses aptitudes répondaient-elles aux difficultés de l’entreprise? Pour lever ses doutes, il se rendit auprès d’un ancien ami de la famille, M. Dan de la Vauterie, alors ingénieur en chef des ponts et chaussées à Saint-Lô. Après un mois d’épreuve, son juge lui garantit le succès. M. Dan de la Vauterie était célibataire. La présence du jeune Le Play égayait son austère solitude. Il le prit pour commensal et devint son professeur. Dans cette communauté d’existence, le maître, travailleur infatigable, au travail dès quatre heures du matin, fortifia et fixa définitivement chez l’élève les habitudes laborieuses que celui-ci avait contractées dès sa plus tendre enfance. Dans les premiers jours de 1824, Le Play fut envoyé à Paris pour faire ses mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, qui venait d’être fondé sur l’emplacement du vieux collège d’Harcourt, et où l’enseignement des sciences avait été très solidement établi. Mon père, alors professeur à ce lycée, n’eut pas de disciple plus studieux ni plus intelligent. Le Play entra, en octobre 1825, à l’École polytechnique, où il fut sergent la première année et sergent-major la seconde. Il en sortit, en octobre 1827, le quatrième de la liste générale et le premier de la promotion des mines, promotion où nous trouvons les noms de Garella, de Reverchon et de Grouchy, qui passa peu après à l’École des ponts et chaussées et embrassa, depuis, la carrière préfectorale.
L’élève des mines fut aussi brillant que le polytechnicien. Logé avec quelques élèves des ponts et chaussées à l’hôtel du Luxembourg, rue Saint-Dominique-d’Enfer, no 12 (aujourd’hui rue Royer-Collard), prenant ses repas chez Rousseau l’aquatique, de légendaire mémoire dans le quartier latin, Le Play ne quittait sa petite chambre d’étudiant que pour le laboratoire de chimie ou la salle d’étude de l’École, apportant à ses manipulations et à ses dessins une rigueur et une adresse sans rivales. Cinq ans après, lors de mon séjour à l’École, on y gardait encore le souvenir d’une analyse de tourmaline, qui avait duré deux mois et dont le procès-verbal était souvent consulté dans les registres du laboratoire.
Le Play ne fit que deux années à l’École. A la suite des examens qui terminèrent l’année scolaire 1828-1829 , M. Becquey, directeur général des ponts et chaussées et des mines, lui écrivait : " Le conseil de l’École m’a donné connaissance des très remarquables succès que vous avez obtenus dans le dernier concours. Bien que vous n’ayez que deux années d’études, vous vous trouvez en tête de la liste des élèves et vous avez acquis 5.767 points de mérite, nombre auquel, depuis la fondation de l’École, n’a jamais atteint aucun élève, même de quatrième année. Je me plais à vous en féliciter et à vous en exprimer toute ma satisfaction. " Nous verrons bientôt que M. Becquey ne s’en tint point à cette lettre d’éloges.
Le Play s’était lié d’une solide amitié avec Jean Reynaud, dont le caractère quelque peu dominateur s’accommodait avec la déférence du conscrit, déférence rendue d’ailleurs facile par l’admiration que ce dernier éprouvait, suivant la bizarre loi des contrastes, pour l’imagination enthousiaste et les aspirations mystiques de son ancien. Jean Reynaud, qui devait finir par un volume de philosophie religieuse, Terre et Ciel, avait commencé par le journal le Globe et le saint-simonisme. Il voyait la grandeur de la patrie dans une transformation sociale, découlant pacifiquement des dogmes de 89, qui lui avaient été inculqués dès l’enfance. Le Play opposait à cette platonique théorie les solides arguments qu’il avait appris à tirer des faits de l’histoire, dans sa première éducation chez son oncle, rue de Grammont, et plus tard à Saint-Lô près de M. Dan de la Vauterie. Sans s’attacher autant que son contradicteur à la méthode d’observation, Jean Reynaud ne repoussait point le projet de soumettre leur controverse à l’épreuve d’un voyage fait en commun dans cette Allemagne du Nord, qu’on vantait comme la patrie de la sagesse. Le Play fit donc agréer à son ami un projet qui devait leur faire visiter en deux cents jours, pendant la belle saison de 1829, les mines, les usines et les forêts des Provinces rhénanes, du Hanovre, du Brunswick, de la Prusse et de la Saxe. L’entreprise des deux amis devait entraîner une dépense supérieure à l’allocation que l’École accordait à ses élèves. Ils se procurèrent à l’avance, par quelques travaux littéraires et scientifiques, le supplément de ressources qui leur était nécessaire, et M. Becquey, après avoir souri de la confiance avec laquelle Le Play prétendait allier l’étude des questions sociales à l’apprentissage de son métier, accueillit avec intérêt ses plans de voyage et accorda aux jeunes ingénieurs une indemnité de campagne exceptionnelle.
Nul, je crois, n’a su voyager comme Le Play. De petite stature, mais de taille dégagée, doué de jarrets d’acier, passé maître dans l’équipement du piéton, bravant les ardeurs du soleil comme les intempéries du ciel, résigné aux mauvais repas et aux mauvais gîtes, il accomplissait sans fatigue des étapes de 50 à 60 kilomètres, aussi dispos à l’arrivée qu’au départ. Nul aussi n’excellait comme lui à tirer des hommes et des choses jusqu’au dernier des renseignements utiles à l’objet qu’il avait en vue. Industriels et ouvriers, propriétaires et paysans, professeurs et étudiants, aubergistes et passants, tous étaient ses tributaires. Que de portes, fermées à d’autres curieux moins habiles, se sont ouvertes devant son irrésistible entregent! Que de secrets n’ont point tenu devant sa finesse cachée sous la plus engageante parole !
Les voyageurs s’étaient proposé, dans chaque contrée, trois buts principaux : " 1° visiter les établissements spéciaux, offrant au mineur des modèles à suivre ou des écueils à éviter, séjourner sur chaque établissement le temps nécessaire pour en observer les faits essentiels, rédiger les notes propres à en conserver le souvenir; 2° se mettre en rapport intime avec les populations et les lieux, pour établir une distinction nette entre les faits entièrement locaux et ceux qui ont un caractère d’intérêt général; 3° rechercher avec sollicitude les autorités sociales de chaque localité, observer leur pratique, recueillir les jugements qu’ils portent sur les hommes et sur les choses. " Dans ce voyage, où ils parcoururent 6.800 kilomètres à pied, Le Play et Reynaud se mirent d’accord à l’égard de certaines thèses économiques reposant sur l’évidence des faits. C’est ainsi, par exemple, qu’ils reconnurent l’excellence des grandes corporations instituées dans les États allemands pour l’exploitation des mines métalliques. Ils ne réussirent pas à s’entendre sur la question sociale, point de départ de leur entreprise; ils comprirent seulement qu’elle présentait une complication dont ils ne s’étaient point tout d’abord rendu compte. Le Play s’affermit dans la pensée que la solution se trouvait en grande partie dans les coutumes du passé. Reynaud conserva ses convictions sur la doctrine du progrès continu et, en général, sur le concours que pouvait prêter, en cette circonstance comme en toute autre, l’esprit de nouveauté. En résumé, " ils revinrent à la fois plus divisés d’opinion et meilleurs amis que jamais ".
De retour à Paris, Le Play se mit activement, dans l’hiver de 1830, à la rédaction de son journal de voyage; mais un terrible accident vint interrompre son travail. Dans une préparation de potassium, une violente projection de cette dangereuse substance l’atteignit aux avant-bras. Accourus à ses cris, les élèves du laboratoire eurent à peine le temps de lui arracher ses vêtements en flamme. Les deux mains étaient horriblement dépouillées et calcinées. On le transporta dans le cabinet chinois attenant à la salle du Conseil, aujourd’hui englobé dans la nouvelle bibliothèque; on y installa un lit provisoire à l’aide de matelas empruntés au personnel de l’École, et, en attendant l’arrivée de sa mère et de sa soeur mandées du Havre en toute hâte, ses camarades se relayèrent tour à tour pour entretenir sur ses mains un courant d’eau froide, seul adoucissement à ses souffrances. Longtemps mal soignée par le médecin de l’École, l’affreuse brûlure ne céda qu’à une habile médication du célèbre Dupuytren. Au bout de dix-huit mois, Le Play retrouva l’usage de ses mains, déformées pour la vie, mais ayant conservé toute leur adresse pour l’écriture, le dessin et les manipulations chimiques.
Dès sa guérison, le blessé reprit et termina son journal de voyage. Ce travail fit époque à l’École et fut pour les élèves le meilleur des modèles. Édifiée sur les services qu’elle pouvait attendre de son auteur, l’Administration s’attacha ce dernier en lui confiant la direction du laboratoire de l’École sous les ordres de Berthier, et la publication des Annales des mines en collaboration avec Dufrénoy.
Le séjour de Le Play au laboratoire fut de très courte durée. Berthier, que d’importants travaux avaient justement placé à la tête de la docimasie française, n’était point disposé à partager cet honneur avec qui que ce fût. Il craignit bientôt de rencontrer un rival dans son collaborateur, et l’association scientifique entre le professeur et l’élève se rompit d’un commun accord. Il n’en fut point de même aux Annales. Ce recueil, commencé sous le titre de Journal des mines vers la fin de 1794, n’avait été que rarement interrompu; mais la rédaction en avait sensiblement faibli dans les dernières années, et avait même été suspendue en 1831. Une nouvelle série, la troisième, fut inaugurée en 1832. De notables additions furent apportées aux matières courantes; la gravure des planches fut plus soignée; d’importants emprunts furent faits aux publications anglaises et allemandes, que le nouveau secrétaire traduisait sans difficulté. Devenu d’adjoint secrétaire en titre, le 7 janvier 1837, Le Play n’en continua pas moins aux Annales son active collaboration. Il les abandonna en 1840, quand il fut chargé du cours de métallurgie.
La publication des Annales valut au jeune ingénieur une notoriété dont il ne tarda point à recueillir le fruit. A cette époque, la prospérité des mines de plomb rouvertes dans les Sierras de Gador et de Lujar avait attiré sur l’Espagne l’attention du monde industriel, et l’on racontait que de non moins riches filons se montraient aux limites communes de l’Estramadure et de l’Andalousie. Le Play fut chargé de vérifier l’exactitude de ces récits et de donner, chemin faisant, un aperçu géologique et statistique des richesses minérales de la péninsule. Nous avons de sa mission un très intéressant volume, extrait des Annales des mines (5e série, tomes V et VI, 1834). Le livre s’ouvre par une rapide descr1ption des lieux que l’auteur a parcourus. Arrivé, par les voies les plus accélérées de l’époque, de Paris à Madrid et de Madrid à Almaras sur le Tage, nous le voyons organiser une caravane de muletiers, qui, portant son bagage, ses livres, ses minéraux, ses plantes, l’accompagna pendant près de deux mois entre le Tage et le Guadalquivir. Le naturaliste curieux de visiter ces contrées avec fruit ne pouvait guère alors compter sur la protection de la loi. Là où le moissonneur n’allait point aux champs sans être armé, le fusil n’était pas moins nécessaire au botaniste et au géologue que la serpe et le marteau. En présence de ces moeurs singulières et dans les longues excursions où l’on passait la nuit au milieu de solitudes recouvertes d’aloès, de palmiers-nains et de figuiers de Barbarie, il était aisé d’oublier qu’on était encore en Europe. Le Play visita successivement Logrosan, aux chimériques gisements de phosphate de chaux; Almaden, cette patrie classique du mercure; Cordoue, Badajoz, Albuquerque, Cacerès; Guadalcanal, fameux, il y a deux siècles, par ses mines d’argent; Le Pedroso, siège de forges fondées à portée de puissants amas de fer oxydé rouge; Rio-Tinto, dont les cuivres exploités au temps des Romains retrouvent aujourd’hui un regain de célébrité; Séville, Cadix, Gibraltar, Malaga, Grenade, d’où, rejoignant la mer à travers les cols glacés de la Sierra-Nevada, le voyageur atteignit la région métallifère des Alpujarras et visita les gîtes célèbres de Gador et de Lujar, où " un puits percé au hasard manquait rarement de rencontrer la galène à moins de 100 mètres de profondeur ". Il était temps d’arriver. La fièvre vint subitement mettre fin aux études du voyageur. Forcé de renoncer à suivre les côtes de Murcie, de Valence et de Catalogne, il rentra en France par la voie de mer. La seconde partie de l’ouvrage, qui en est la plus considérable, est spécialement consacrée, aux observations faites en Estramadure et dans le nord de l’Andalousie. Elle est accompagnée d’un essai de carte géologique de la contrée et de croquis pittoresques dessinés sur place au cours du voyage.
En 1832, avant son départ pour l’Espagne, Le Play avait donné aux Annales (3e série, tome II) un travail statistique, intitulé : " Observations sur le mouvement commercial des principales substances minérales entre la France et les puissances étrangères, pendant les douze dernières années, et particulièrement pendant les années 1829-1830-1831. " Les tableaux qui terminent cette notice avaient été dressés à l’aide des documents officiels émanant de l’administration des douanes; mais les quelque quarante pages qui les précèdent en formaient un des plus intéressants commentaires. Les impressions que Le Play avait rapportées de son voyage dans le Hartz étaient encore toutes présentes à son esprit, et c’est sous leur influence qu’il écrivait : " Dans le Hartz, où l’existence d’une population de 50.000 habitants est uniquement fondée sur l’exploitation des mines, l’administration, justement alarmée pour les nombreux intérêts dont elle est la protectrice, a fait d’énergiques efforts pour combattre la concurrence des plombs espagnols. M. Haussmann, de Göttingen, envoyé en Espagne avec mission spéciale d’observer l’état des choses, établit dans son rapport que les mines des Alpujarras, livrées à un gaspillage sans mesure, ne pourront longtemps soutenir leur énorme production. Encouragée par cette assurance, aidée par son admirable organisation, l’administration du Hartz a présenté, dans ces circonstances difficiles, un bien remarquable exemple des avantages de l’association dans l’industrie minérale. Des perfectionnements de tous genres ont été tentés, des réductions ont été faites dans les dépenses, et, avec un désintéressement qu’on ne saurait trop louer, le Conseil de Clausthal a voulu que les économies portassent seulement sur le superflu des officiers des mines, afin que le nécessaire fût conservé aux ouvriers. " Sous l’ingénieur perçait déjà l’économiste.
Pour le fond comme pour la forme, le travail statistique de Le Play fut très remarqué, et il eut sa grande part dans le projet de loi que le ministre fit sanctionner par la Chambre, le 23 avril 1833. Aux termes de l’article 5 de cette loi, il devait être publié, à l’ouverture de chaque session, un compte rendu des travaux métallurgiques, minéralogiques et géologiques que les ingénieurs des mines auraient exécutés, dirigés ou surveillés. Le ministre des travaux publics institua immédiatement une Commission permanente de Statistique de l’Industrie minérale. Le Play fut nommé membre de cette commission par arrêté du 31 janvier 1834, et, en réalité, chargé seul du travail qu’elle devait annuellement présenter. Le premier compte rendu avait trait à l’année 1833 ; il fut distribué aux Chambres de 1834, Thiers étant ministre. Chaque année, les ingénieurs eurent, dès lors, à dresser (quelques-uns en les maudissant) sept tableaux de dimensions uniformes, dont les têtes de colonne avaient été libellées par Le Play, après les études les plus approfondies au point de vue de la statistique comme à celui de l’art des mines. C’est ainsi que 602 tableaux venaient, vers la fin de l’année, couvrir les tables de la mansarde donnée comme cabinet de travail au secrétaire de la Commission de Statistique, dans les bâtiments affectés aujourd’hui à l’École des ponts et chaussées. En quatre ou cinq mois, ces tableaux, soigneusement dépouillés, se résumaient en un in-4e, de format, de caractère, de disposition toujours les mêmes, et contenant, en outre, pour relever l’intérêt de cette monotone publication, d’instructives notices sur les houilles, sur les fers, sur les métaux. Adjoint à Le Play comme collaborateur, j’ai vu chaque année grandir, sous sa féconde impulsion, la publication destinée à tenir le pays au courant des progrès de notre industrie minérale. Entre temps, il donnait à l’Encyclopédie nouvelle (1848) un grand article, intitulé : " Vues générales sur la statistique, suivies d’un aperçu d’une statistique générale de la France. "
L’oeuvre anonyme à laquelle Le Play vouait toute son activité, et dont l’administration avait tout l’honneur officiel, fut religieusement maintenue, de 1834 à 1848, dans la voie où il l’avait dirigée. La République de 1848 avait à faire des économies dans ses budgets : la loi de 1833 fut rapportée par une loi de 1848, et le Compte rendu condamné à ne paraître que tous les cinq ans, et plus tard tous les trois ans. Appelé le 20 juillet 1848 aux fonctions d’inspecteur des études à l’École des mines, Le Play quitta la Commission de Statistique. Le volume qui suivit son départ parut en 1853; il comprenait les années 1847 à 1852, et perdait l’uniformité de composition si précieuse pour les recherches dans ce genre de publications périodiques.
Le repos n’était pas fait pour Le Play. Après avoir donné les mauvais mois de l’année à la publication du Compte rendu, il demandait et obtenait sans peine des missions à l’étranger. La Belgique, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande furent tour à tour parcourues en 1835 et 1836; chaque mission donna lieu à un important travail concernant la production de la houille et du fer dans ces régions privilégiées. En 1837, il saisit avec empressement l’occasion d’étendre ses études aux confins orientaux de l’Europe. Un des plus riches propriétaires de la Russie, M. Anatole Demidoff, désireux de jeter sur son nom un éclat autre que celui de l’or, avait conçu le projet de faire à ses frais une reconnaissance scientifique des terrains carbonifères du Donetz, sur la rive droite du Don, entre la mer Caspienne et la mer d’Azof. Chargé d’organiser l’expédition, Le Play s’adjoignit un personnel comprenant un ingénieur des ponts et chaussées, un géologue, un naturaliste, un dessinateur, qui l’accompagnèrent par terre jusqu’au lieu de destination, et il expédia par mer un attirail complet d’outils de mine et d’engins de sondage avec quelques maîtres-ouvriers destinés à former et à diriger les manoeuvres pris dans le pays. Après avoir traversé l’Autriche et les Provinces danubiennes, l’expédition s’engageait avec admiration, en juin 1837, dans les steppes de la mer Noire, " où les herbes, écrit Le Play, s’élevaient parfois assez haut pour engloutir les chevaux " . Chacun se mit à l’oeuvre suivant sa spécialité, et, de retour en France, fournit son contingent, texte et dessins, à la publication de luxe qui compléta, en 1842, la libérale entreprise de M. Demidoff. La descr1ption des terrains carbonifères fut la part de Le Play dans cette oeuvre commune. Mais, dès 1838, il avait adressé au ministre du commerce d’intéressantes lettres sur l’organisation économique et commerciale de la Russie méridionale. Ces lettres doivent se trouver dans les archives du ministère.
La campagne scientifique du Donetz eut pour Le Play des conséquences tout à fait inattendues. M. Demidoff possédait dans l’Oural de riches mines d’or, de platine, d’argent, de cuivre et de fer. Ces mines, livrées à d’inhabiles directeurs, étaient exploitées suivant de routinières méthodes, aussi dispendieuses que peu productives. M. Demidoff, qui avait été à même d’apprécier la puissance organisatrice de son collaborateur, soumit ces méthodes à son examen. Un premier voyage dans l’Oural, fait en 1844, démontra sans peine à Le Play toute leur imperfection, et, après avoir étudié, soit sur place, soit à Paris, les améliorations dont elles étaient susceptibles, il conclut avec M. Demidoff une association dans laquelle l’un apportait ses domaines et ses capitaux, l’autre sa science et son talent. L’extraction des minerais, leur préparation mécanique, leur traitement métallurgique, tout fut renouvelé et approprié aux enseignements de la théorie et de la pratique les plus rationnelles. De son cabinet, Le Play gouvernait jusqu’à 45.000 ouvriers travaillant dans l’Oural sous son invisible direction. Un second voyage, fait en 1853, lui permit de vérifier par ses propres yeux les résultats de la nouvelle organisation. Ces résultats se traduisaient par une plus-value considérable sur le rendement des mines.
J’ai dit plus haut comment Le Play employait en voyages les loisirs que lui laissait, entre les sessions des Chambres, la Statistique de l’Industrie minérale. L’Angleterre fut visitée en 1842 ; l’Allemagne du Nord et la Russie en 1844; le Hartz, le Danemark, la Suède et la Norvège en 1845; la Belgique, l’Autriche, la Hongrie et l’Italie du Nord en 1846; la Suisse, les Provinces danubiennes et la Turquie centrale en 1848; l’Auvergne en 185o; l’Angleterre, les Provinces rhénanes, la Westphalie, l’Erzgebirge en 1851 ; l’Autriche et la Russie en 1853. Dans ses nombreux voyages, Le Play se proposait un double but. Il dirigeait ses observations et recueillait ses notes au point de vue technique et au point de vue social, comme ingénieur et comme économiste. D’une part, en effet, il se mettait de longue main en état de remplacer Guényveau dans la chaire de métallurgie, qui devait vaquer en 1840. D’autre part, il préparait, comme emploi de ses dernières années, une prédication écrite des doctrines propres à enrayer la décadence des populations européennes en général et de la nation française en particulier. Nous aurons plus tard à le suivre sur ce dernier terrain. Je n’ai, pour le moment, à m’occuper que du professeur. Les ingénieurs de ma génération sourient encore au souvenir du cours de métallurgie qui leur était enseigné à l’École, toujours le même depuis plusieurs années. Il était donné à Le Play de le rajeunir dès son début, et, plus tard, de le tenir au courant des progrès faits par la science, tant en France qu’à l’étranger. J’ai sous les yeux, au moment où je trace ces lignes, les trois volumineux cartons où ont pris place une centaine de leçons rédigées suivant le plan le plus méthodique, illustrées de croquis dessinés et cotés de la main du maître. Je puis suivre dans chacune les modifications subies d’année en année par la rédaction, à la suite d’observations ou de théories nouvelles, et, arrivé au dernier cahier, j’éprouve un véritable sentiment de tristesse à la pensée que ces feuilles, fruit de tant de labeur, fruit de tant de fatigues, vont, après cette suprême revue, s’ensevelir dans des archives de famille sous la poussière de l’oubli. Nos Annales auront, du moins, conservé quelques pages de ce vaste et beau manuscrit.
Le tome VII de la 3e série (1835) contient une notice sur la préparation de l’acide sulfurique fumant dans le nord de l’Allemagne.
Dans le tome X (1836), on trouve la descr1ption de l’affinage des plombs argentifères par cristallisation, suivant la méthode due à l’ingénieur anglais Pattinson, méthode qui ne remplace point complètement la coupellation, mais qui permet de restreindre dans une proportion considérable la quantité de plomb soumise à cette dispendieuse opération.
Le tome XV (1839) fait connaître une ingénieuse disposition employée avec succès par M. Oeynhausen, conseiller supérieur des mines de l’arrondissement de Bonn, dans un sondage que le gouvernement prussien exécutait à Neusalzwerk, près de Minden, pour la recherche de sources salées.
Un travail fort remarqué parut dans le tome XIX (1841) sur le mode d’action du carbone dans la cémentation et sur les réactions caractérisant les fourneaux à courant d’air forcé. Le Play avait déjà saisi de ce sujet l’Académie des sciences, dans sa séance du 18 janvier 1836. Le mémoire donné aux Annales eut pour but de compléter les considérations soumises à l’Académie. La condition fondamentale de toute réaction chimique est un contact intime entre les deux agents destinés à la produire. Il faut donc pour le succès de l’opération qu’un de ces agents au moins soit amené à l’état liquide ou gazeux. Quand cette condition est remplie et que la réaction commence à la surface de chaque fragment solide, celle-ci se propage rapidement dans l’intérieur du fragment en vertu de la faculté d’infiltration propre aux fluides. Cette conclusion, qu’on peut tirer à priori de la constitution moléculaire des corps, se trouve établie plus fermement encore par l’observation de tous les faits chimiques. Le carbone mis en présence de corps oxydés semble faire exception à la règle : son pouvoir réducteur s’exerce jusqu’au coeur même des fragments d’oxyde. Cette anomalie avait depuis longtemps attiré l’attention des chimistes et des physiciens, qui, ne sachant l’expliquer, caractérisaient ce mode de réduction par le mot spécial de cémentation. La théorie proposée par Le Play donne l’explication la plus naturelle du phénomène. L’on reconnaît par l’expérience qu’en cémentant les oxydes métalliques à l’aide du carbone solide, on les plonge en réalité dans une atmosphère où domine le gaz oxyde de carbone. Si donc ce gaz a la propriété de réduire tous les corps oxydés réputés réductibles par le carbone, l’action du carbone solide rentre dans les lois ordinaires de la chimie. Le carbone solide n’est plus qu’une matière première servant à préparer le gaz réducteur; la réduction de l’oxyde métallique par l’oxyde de carbone produit de l’acide carbonique, et ce dernier, en régénérant au contact de la brasque son équivalent d’oxyde de carbone, contribue indéfiniment au progrès de la réaction. Ainsi exposée, la théorie donnée par Le Play semble des plus simples; le problème de l’oeuf attribué à Christophe Colomb ne parut-il pas aussi des plus faciles, lorsqu’il en eut fait voir la solution? La théorie des fourneaux à courant d’air forcé n’était pas moins obscure que celle de la cémentation des oxydes. Les métallurgistes admettaient comme point de départ que les minerais oxydés se réduisaient dans ces fourneaux par cémentation sous l’influence du carbone solide. Après une étude approfondie des fourneaux à tuyères, Le Play a démontré, théoriquement et pratiquement, le rôle qu’y joue l’oxyde de carbone, bien que la réduction des oxydes y soit due à des réactions essentiellement différentes de celles qui constituent la réduction par cémentation en vase clos. En effet, les enceintes de cémentation sont, entre autres circonstances, caractérisées par les conditions suivantes : 1° l’oxygène nécessaire à la génération de l’oxyde de carbone est fourni par l’oxyde à réduire ; 2° la chaleur nécessaire à la réduction est produite en dehors de l’enceinte de réduction et indépendamment de la réaction chimique qui engendre l’oxyde de carbone. Dans les fourneaux à tuyères : 1° l’oxygène nécessaire à la production de l’oxyde de carbone est fourni par l’air atmosphérique; 2° la chaleur se développe dans l’enceinte même où a lieu la réaction, et ce développement de chaleur est intimement lié à la production de l’oxyde de carbone. Entre les deux classes d’appareils, il n’existe qu’une seule analogie : c’est l’identité de l’agent gazeux qui produit la réduction des corps oxydés. Je n’insisterai point davantage, renvoyant au mémoire de Le Play le lecteur curieux de suivre, dans tous ses détails, l’étude de phénomènes que l’auteur a éclairés d’une lumière toute nouvelle et dont il a donné la théorie, actuellement professée dans tous les cours et dans tous les traités de métallurgie.
Le tome III de la 4e série (1843) renferme un mémoire sur la fabrication de l’acier dans le Yorkshire, avec considérations ayant trait à l’état actuel et à l’avenir probable de la fabrication de l’acier sur le continent européen et particulièrement en France. Comme suite à cette publication, Le Play a donné, trois ans après, dans le tome IX, un nouveau mémoire, concernant la fabrication et le commerce des fers à acier dans le nord de l’Europe, et traitant des questions soulevées depuis un siècle et demi par l’emploi de ces fers dans les aciéries françaises.
En 1848, Le Play réunit dans un même volume les articles qu’il venait de donner aux Annales (5e série, tome XIII), sous le titre: "Descr1ption des procédés métallurgiques employés dans le pays de Galles pour la fabrication du cuivre, et recherches sur l’état actuel et sur l’avenir probable de la production et du commerce de ce métal. " L’auteur indique au § 1er les conditions économiques dans lesquelles se trouvent placées les fonderies galloises. Il signale dans le § 2 les caractères distinctifs du traitement propre à ces fonderies et la classification établie par les fondeurs dans les nombreuses sortes de minerais apportés de tous les points du globe. Les § 3 à 12 ont spécialement pour objet la pratique et la théorie des dix manipulations principales de la méthode galloise. Il développe dans le § 13 les moyens de donner à la descr1ption des phénomènes métallurgiques la précision, qui est la condition essentielle du progrès dans toutes les sciences, et qui a jusqu’à ce jour manqué à la métallurgie. Comme application de ces principes, il groupe les diverses réactions du traitement gallois dans une série de tableaux, où l’on trouve la proportion relative et la composition élémentaire de toutes les matières intervenant dans chacune des dix opérations et de tous les produits fournis par ces dernières. Dans le § 14, il indique avec détail les frais de toute nature auxquels donne lieu le traitement d’une tonne de minerai, seul critérium de la valeur scientifique et industrielle d’un procédé métallurgique. Dans le § 15, il résume les observations qu’il a recueillies, dans une période de quinze années, sur la production, le commerce et la consommation du cuivre, apprécie l’influence exercée depuis un siècle et spécialement depuis vingt ans par les fonderies de la Grande-Bretagne, expose les conséquences résultant, pour les consommateurs européens, du régime restrictif récemment établi dans ce pays, et, jetant un coup d’oeil sur l’avenir, insiste sur les motifs qui doivent pousser l’industrie française à extraire elle-même une partie du cuivre qui lui est nécessaire des minerais étrangers traités jusqu’alors exclusivement dans la Grande-Bretagne. Enfin, dans un intéressant appendice, il décrit des méthodes nouvelles de dosage rapide qui, de 1842 à 1848, lui ont permis, sans interrompre ses autres travaux, de faire plus de sept cents essais sur les scories et les produits cuivreux des principales usines de l’Europe.
Le volume consacré par Le Play aux usines à cuivre du pays de Galles était, dans sa pensée, le spécimen d’un traité complet de métallurgie, pour lequel il avait rassemblé d’immenses matériaux et qui devait avoir pour titre : l’Art métallique au XIXe siècle, en imitation du De arte metallicâ d’Agricola. Cette entreprise n’a pas abouti. L’auteur suivit, hors du corps des mines, d’autres destinées. Mais, eût-il persévéré dans sa première carrière, je doute qu’il eût pu réaliser un projet formé sur un aussi vaste plan. Indépendamment des frais considérables qu’aurait entraînés l’impression du texte et la gravure des planches, une vie humaine n’aurait point suffi pour mener à terme une publication, où la descr1ption d’une seule méthode remplissait un volume de cinq cents pages.
Le dernier mémoire que Le Play ait donné aux Annales se trouve dans le tome III de la 5e série (1853). Il traite d’une méthode nouvelle employée pour la fabrication du fer dans les forêts de la Carinthie, et des principes que doivent suivre les propriétaires de forêts et d’usines au bois pour soutenir la lutte engagée, dans l’occident de l’Europe, entre le bois et le charbon de terre.
Nous voici parvenus à l’ère de ces grands tournois auxquels l’Angleterre et la France convoquèrent tour à tour, à Londres et à Paris, les industriels, les commerçants, les artistes de la terre entière. L’Angleterre donna le signal et inaugura, en 1851, dans son féerique Cristal-Palace la première Exposition universelle. Le Play y fut membre du 21e jury, et remit à la commission française un rapport sur la coutellerie et les outils d’acier, qui a été imprimé à part en 1854 à l’Imprimerie impériale, et qui forme à lui seul comme un traité sur cette intéressante matière.
La France eut à son tour son Exposition, qui, décrétée le 8 mars 1853, devait s’ouvrir le 1er mai 1855. La Commission impériale chargée de la diriger avait été placée sous la présidence du prince Napoléon. Le Play, l’un des commissaires, eut tout d’abord à préparer un système de classification des produits. Dans cette aride mission, il déploya des qualités spéciales, qui devinrent des plus précieuses en présence des mille difficultés de détail que soulevait l’entreprise. Le 11 août 1854, le Comité d’exécution, trop lent dans ses allures, fut remplacé par un commissaire général, le général Morin, qui lui-même céda ses fonctions à Le Play, le 23 mai 1855. L’on sait que l’Exposition de 1855 s’ouvrit officiellement le 15 mai, aux Champs-Élysées, dans le Palais de l’Industrie, auquel fut annexée une longue galerie provisoire s’étendant sur le quai de Billy, depuis la place de la Concorde jusqu’au pont de l’Alma. Ce qu’on connaît moins, ce sont les obstacles que Le Play, tardivement chargé du commissariat général, rencontra dans l’accomplissement de son mandat. Insuffisance des bâtiments, lenteur des décisions, retard des constructions, inexactitude des envois, rivalité des emplacements, tout conjurait contre ses efforts. Le succès n’en fut pas moins assuré. Le nombre des visiteurs dépassa 5.000.000, et l’Exposition, qui devait fermer le 31 octobre, fut, à la demande du public, prolongée au 15 novembre. La liste des récompenses fut insérée au Moniteur officiel le 8 décembre, et, quelques jours après, Le Play était nommé conseiller d’État. Il dut, en conséquence, abandonner ses fonctions d’inspecteur des études à l’École des mines et descendre de sa chaire de métallurgie, renonçant ainsi, non sans regrets, aux études qui avaient si bien rempli vingt-six années de sa vie.
Le Play apporta au conseil d’État ses habitudes de travail et prit une part active à la solution d’une question qui passionna en son temps l’opinion parisienne, celle de la boulangerie. La question de la boulangerie n’en est plus une aujourd’hui. Avec la promptitude des communications par mer et la multiplicité des chemins de fer sillonnant l’Amérique et l’Europe, les populations ne sauraient plus craindre la disette. Il n’en allait point tout à fait de même, il y a une vingtaine d’années. A cette époque, le nombre des boulangeries était limité, et le pain taxé officiellement suivant le cours des céréales. Fallait-il maintenir une industrie, qui intéresse à un si haut degré le repos public, sous la tutelle de l’administration, en réglant son monopole? Convenait-il de lui donner la liberté, en lui laissant pour seul frein la concurrence? La question divisait les meilleurs esprits. Après une enquête restée célèbre, qu’il étendit jusqu’au commerce des grains, Le Play conclut en faveur de la liberté. Son avis fut adopté par le gouvernement.
La troisième Exposition universelle eut lieu à Londres en 1862. Le Play y dirigea la section française en qualité de commissaire général.
En 1867, l’honneur de la quatrième Exposition revint à la France. Elle fut, comme celle de 1855, confiée à une Commission impériale, placée sous la présidence du prince Napoléon, qui donna peu après sa démission, et Le Play, commissaire général, fut en réalité l’organisateur tout puissant de cette grande oeuvre. Par une combinaison aussi hardie que nouvelle, l’État, la Ville de Paris et le public furent associés au succès financier de l’entreprise. L’État devait fournir 6 millions, la Ville 6 millions, et le public 8 millions. Ces 8 millions ne constituaient qu’un fond de garantie. Les souscr1pteurs n’étaient tenus à versement qu’en cas d’excès des dépenses sur les recettes. Dans le cas d’excès des recettes sur les dépenses, le bénéfice devait être partagé par tiers entre l’État, la Ville et l’association de garantie. Le capital de 8 millions fut divisé en 8.000 actions de 1.000 francs, dont la souscr1ption n’était accompagnée que d’un dépôt provisoire de 20 francs par action. Les demandes affluèrent et constituèrent, le 20 juillet 1865, date de la clôture des listes, un capital de 10.347.000 francs. La plupart des souscr1pteurs, uniquement soucieux de l’honneur du pays, étaient résolus à y coopérer au besoin par des sacrifices. Ces sacrifices leur furent épargnés. Les promesses faites dans l’appel au public furent non seulement tenues, mais dépassées. La balance des opérations financières, depuis l’origine jusqu’au 4 février 1872, date de la clôture des comptes, donna :
francs
Pour les recettes, en nombre rond . ..... 26.257.000
Pour les dépenses, en nombre rond. ..... 23.491.000
Ce qui constituait un bénéfice de. ...... 2.766.000
Dont le tiers était de . ............ 922.000
Le dépôt de 20 francs par action avait été antérieurement restitué avec intérêt annuel de 5 p. 100. Chaque actionnaire reçut donc près de 90 francs par action, en échange de sa confiance en l’oeuvre et, l’on peut presque dire, de son patriotique désintéressement. Ce résultat constituait un heureux précédent dont le public ne devait point perdre le souvenir et qui aurait pu faciliter la tâche aux organisateurs des expositions futures. Les errements de 1867 ne furent point suivis en 1878, et de larges emprunts au budget ont payé l’éclat de la dernière Exposition.
Le choix de l’emplacement donna lieu à de longues controverses. Les projets qui occupèrent le plus l’attention publique avaient pour objet : l’un de mettre à profit le palais de l’exposition permanente d’Auteuil; l’autre d’employer, en l’étendant par des annexes, le palais des Champs-Élysées. Le Champ de Mars remplissait mieux les conditions du programme qu’on s’était imposé. Sa surface était de 45 hectares; on y accédait par de larges voies; la proximité de la Seine lui assurait le bienfait des communications par eau, et il était facile de le relier par un embranchement avec les chemins de fer du continent. Le Play exigea et obtint l’emplacement qui pouvait seul assurer le succès de l’Exposition. La berge de la Seine fut affectée au matériel de l’art nautique et l’île de Billancourt aux animaux, aux produits du travail agricole et aux méthodes de production.
Il fallait encore arrêter le plan du palais. Instruit par l’expérience de 1855, Le Play fit prévaloir un projet longuement étudié, qui avait pour point de départ une double classification des produits, par nature d’objets et par nationalité. La surface de l’espace à couvrir fut portée à 150.000 mètres carrés. La forme adoptée pour le palais fut celle de deux demi-cercles de 190 mètres de rayon, reliés par un rectangle de 38o mètres sur 110 mètres. Intérieurement, deux systèmes de division répondirent à la double classification des produits. Le premier était formé de zones concentriques recevant les groupes des produits similaires de tous les pays; le second, de secteurs rayonnant du centre du palais et consacrés chacun à une même nation. Par cette disposition, les voies de circulation concentriques facilitaient l’étude comparative d’une même industrie dans le monde entier ; les voies rayonnantes permettaient de passer en revue toutes les industries d’un même pays. La division en zones et en secteurs fut étendue au parc qui environnait le palais, dans la mesure toutefois que permettaient les convenances de la décoration.
L’Exposition, ouverte le 1er mai, fut close le 3 novembre. Le nombre d’entrées par les tourniquets avait été de 12 millions. Ce chiffre dispense de tout commentaire. Le commissaire général, à qui revenait pour une si grande part le succès de la quatrième Exposition universelle, fut nommé sénateur. Le 12 août 1868, il reçut le titre d’inspecteur général des mines honoraire.
Entré en novembre 1827 à l’École des mines, Le Play avait été nommé :
Aspirant ingénieur. ............ le 1er sept. 1830
Ingénieur de 2e classe. .......... le 25 oct. 1831
Ingénieur de 1e classe .......... le 26 déc. 1836
Ingénieur en chef de 2e classe ... le 29 juillet 1840
Ingénieur en chef de 1e classe. ... le 1er juin 1848
Nous avons suivi Le Play dans sa carrière d’ingénieur des mines, de conseiller d’État, de sénateur. Il nous faut maintenant revenir de quelques années sur nos pas pour considérer en lui l’économiste. Nous l’avons vu, dès sa mission d’élève mineur, défendant contre Jean Reynaud la prééminence de la méthode d’observation sur les théories préconçues pour résoudre les grands problèmes de la science sociale. Nous l’avons vu plus tard, dans ses nombreux voyages à travers l’Europe et jusqu’aux versants asiatiques de l’Oural, faire dans ses carnets deux parts, l’une consacrée aux comptes rendus de la statistique minérale et aux leçons de son cours de métallurgie; l’autre destinée à un grand ouvrage où il se proposait d’établir par les faits les conditions dans lesquelles une nation prospère et grandit, ou souffre et déchoit. Les matériaux qu’il avait accumulés et révisés sans cesse, pendant dix-huit années d’observations, furent publiés pour la première fois, en 1855, dans les Ouvriers européens, format grand in-folio, avec le concours des presses de l’Imprimerie impériale. Le 28 janvier 1856, l’Académie des sciences décernait à l’ouvrage le prix de statistique fondé par Monthyon, et, le 11 avril suivant, la Société d’Économie sociale se formait pour appliquer à ses études la méthode inaugurée dans les Ouvriers européens. Cette société compte aujourd’hui près de trois cents membres.
La première édition des Ouvriers européens fut rapidement épuisée. Le Play en publia une seconde dans le format in-8° et en six volumes, qui parurent successivement de 1877 à 1879. La méthode employée dans l’ouvrage ne fut point inventée de toutes pièces. Elle s’est imposée peu à peu à Le Play, à mesure qu’il acquérait par l’observation la connaissance des faits, matériels et moraux, présidant à l’organisation des sociétés. Ces faits sont répartis dans trois cents monographies, parmi lesquelles l’auteur en a choisi cinquante-sept, qui lui ont paru représenter le mieux diverses contrées de l’Europe et dont la liste me semble de nature à intéresser le lecteur :
L’ORIENT. - Bachkirs. - Paysans et charrons (à corvées). - Forgeron et charbonnier des usines à fer de l’Oural. - Charbonnier et marchand de grains des laveries d’or de l’Oural. - Paysans et portefaix émigrants (à l’abrok). - Forgeron bulgare de Samakowa. - Iobajjy ou paysans hongrois (à corvées). - Paysans (en communauté) de Bousrah. - Menuisier-charpentier de Tanger.
LE NORD. - Forgeron de Dannemora. - Fondeur du Buskerud. - Mineur du Hartz. - Armurier de Solingen. - Pêcheur-côtier de Marken. - Coutelier de Londres. - Coutelier de Sheffield. - Menuisier de Sheffield. - Fondeur à la houille du Derbyshire.
L’OCCIDENT (populations stables). - Fondeurs slovaques de Schemnitz. - Fondeur du Hundsrück. - Métayer de la Toscane. - Ferblantier-couvreur d’Aix-les-Bains. - Métayer de la Vieille-Castille. - Pêcheur-côtier de Saint-Sébastien. - Bordier de la Basse-Bretagne. - Paysan savonnier de la Basse-Provence. - Paysan du Lavedan. - Charbonnier de la Carinthie. - Luthier de la Saxe. - Brassier de l’Armagnac.
L’OCCIDENT (populations ébranlées). - Compagnon menuisier de Vienne. - Tisserand du Godesberg. - Compositeur-typographe de Bruxelles. - Mineur de Pontgibaud. - Paysan basque du Labour. - Manoeuvre-agriculteur du Morvan. - Bordier-agriculteur de la Champagne pouilleuse. - Maître-blanchisseur de la banlieue de Paris. - Charpentier (du Devoir) de Paris. - Luthier du Werdenfels. -Mineur émigrant de la Galice (résidence d’été). - Mineur émigrant de la Galice (résidence d’hiver). - Fondeur au bois du Nivernais. - Maréchal-ferrant du Maine.
L’OCCIDENT (populations désorganisées). - Mineur de la Carniole. - Horloger de Genève (jeune ménage). - Bordier émigrant du Laonnais. - Bordier-vigneron de l’Aunis. - Tisserand de Mamers. - Chiffonnier de Paris. - Manoeuvre, à famille nombreuse, de Paris. - Tailleur d’habits de Paris. - Débardeur de Port-Marly. - Horloger de Genève (vieux ménage). - Manoeuvre - agriculteur du Maine. - Tisserand des Vosges. - Lingère de Lille. - Auvergnat brocanteur de Paris.
La descr1ption d’une famille ouvrière convenablement choisie fait connaître la plupart des autres familles, et, comme l’auteur indique dans un cadre inflexible, toujours à la même place, les recettes et les dépenses auxquelles aboutissent en définitive tous les actes de la famille, cette règle uniforme dans l’établissement du " budget " rend comparables les observations spéciales aux diverses monographies.
De 1864 à 1878, Le Play a donné six éditions de la Réforme sociale en France, déduite de l’observation des peuples européens. Depuis 1789, dix formes de souveraineté ont régi la France. Chacune d’elles a été instituée, puis renversée par la violence. Bien des hommes d’État, bien des écrivains ont cherché le remède à cette instabilité sans exemple. Quoique étranger aux lettres et à la politique, Le Play a voulu découvrir le secret d’un gouvernement qui n’aurait point l’effusion du sang pour début ou pour terme. Après avoir établi que les fausses théories de l’histoire font généralement prendre le change sur les conditions de la Réforme, l’auteur démontre que l’observation des faits sociaux constitue la seule méthode propre à donner la solution de ce grand problème. Dans les quatre volumes qui composent aujourd’hui son ouvrage, il traite successivement de la religion, de la propriété, de la famille, du travail, de l’association, des rapports privés, du gouvernement. C’est là que pour la première fois il a revendiqué en faveur de la France la liberté testamentaire qui existe en Angleterre et en Amérique. Dans la session de 1865, une proposition tendant à accroître l’autorité du père de famille fut présentée au Corps législatif par le baron de Veauce et cinquante-et-un de ses collègues. Leurs efforts échouèrent devant l’opinion issue des dogmes de 1789.
L’Organisation du travail (1870-1871), l’Organisation de la famille (1870-1876) dérivent de la Réforme sociale et forment comme des parties détachées et agrandies de ce vaste cadre, la Constitution essentielle de l’humanité (1880) en est, au contraire, comme une réduction à très petite échelle.
Dans la Constitution de l’Angleterre (1875), Le Play a résumé les documents que lui avaient fournis ses nombreux voyages dans la Grande-Bretagne, et surtout ceux qu’il avait recueillis pendant son long séjour à Londres, lors de l’Exposition de 1862; car, suivant le mot heureux d’un de ses plus affectionnés disciples, tout était pour Le Play motif ou moyen.
Je passe sous silence une foule de lettres ou de notices qui ont paru sous forme de brochures. La spécialité du recueil pour lequel j’écris m’interdit de trop longs développements sur des sujets étrangers à l’art de l’ingénieur des mines.
Les amis de Le Play l’avaient longtemps pressé de fonder une revue périodique, destinée à répandre sa doctrine. Le livre et la parole n’ont qu’une portée restreinte; le journal, s’il réussit, pénètre partout et impose sa propagande. Il céda à leur désir, et l’année 1881 a vu naître, sous son patronage, La Réforme sociale, revue paraissant tous les quinze jours, publiée, sous la direction de M. Edmond Demolins, avec le concours de la Société d’Économie sociale, de la Société bibliographique et des Unions de la paix sociale. Les abonnés n’ont point manqué à la nouvelle venue. Elle en est à son quatrième volume, étendant progressivement le cercle des matières qu’elle embrasse et la liste des écrivains qui y collaborent. Dans le numéro du 15 février 1882, Le Play écrivait, et ces lignes sont presque les dernières que sa main ait tracées : " Au terme d’une journée de marche, le voyageur aime à se recueillir dans le calme du soir; il jette un regard sur le chemin parcouru, avant que les ombres de la nuit ne descendent cacher la terre pour ne laisser voir que le ciel aux mystérieuses clartés. Par une faveur de la Providence, après une carrière qui n’a pas été sans labeur, je jouis de ce repos. J’ai vu grandir peu à peu l’École de la paix sociale, et, me reportant par la pensée vers l’état des esprits au début de mes travaux, je me plais à croire qu’elle n’a pas été sans quelque utilité. J’ai confiance dans son avenir. Sans doute, il ne faudra pas épargner notre peine, et la route paraîtra longue encore, même à ceux qui viendront après moi. Mais, avec l’aide de Dieu, ils accompliront la tâche commencée, parce qu’ils garderont toujours pour règle de servir la cause de la vérité pour assurer le règne de la paix. "
Le 4 septembre 1870, le sénat impérial périssait avec l’Empire emporté par le désastre de Sedan, et Le Play fut rendu à la vie privée. Il habitait à cette époque le premier étage d’une ancienne et belle maison située sur la place Saint-Sulpice, qui avait appartenu à Thénard et que possède encore la famille du célèbre chimiste. C’est là que, dans l’embrasure de la fenêtre éclairant son vaste cabinet, debout devant un bureau-pupitre, il rédigeait ou réimprimait ses traités d’économie sociale et subvenait à la plus active des correspondances, heureux de toute nouvelle adhésion à ses doctrines, venue de Paris, de la province ou de l’étranger. En octobre 1880 se déclara la première crise de l’affection du coeur qui devait l’emporter. Il s’en releva promptement, mais il dut se condamner dès lors à la plus rigoureuse retraite. Après le travail du jour, son salon recevait, toujours ouvert, les amis de la maison ou les étrangers de passage. La lecture à haute voix, une partie de whist, la préparation de la Revue, et surtout une causerie sérieuse ou gaie, suivant les visiteurs, remplissaient tour à tour ces réunions du soir, auxquelles présidait avec une grâce incomparable la dévouée compagne qui, depuis quarante années, donnait à Le Play le bonheur intime du foyer. A neuf heures apparaissait le samovar, souvenir des voyages de Russie. La sonnerie de dix heures donnait le signal de la retraite. Tel était l’invariable train de vie qu’interrompirent seules quelques crises, toujours très courtes, de la maladie. La soirée du 4 avril dernier s’était écoulée pareille à toutes les autres. Le lendemain, vers midi, Le Play perdit subitement connaissance, et finit sans un cri, sans une souffrance. Il laisse un fils, qu’il avait été heureux d’unir à la fille d’un ancien camarade, Michel Chevalier, et dont il a pu voir grandir la jeune postérité.
Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play a voulu dormir son suprême sommeil au milieu des champs qu’il a tant aimés. Agronome à temps perdu, il avait acquis, près de Limoges, le domaine de Ligoure, sur la commune du Vigen. C’est dans l’humble cimetière de cet obscur village du Limousin que repose aujourd’hui celui qui fut : Inspecteur général des mines, Conseiller d’État, Sénateur de l’Empire, Commissaire général des Expositions universelles de 1855, 1862 et 1867, Fondateur de la Société d’Économie sociale, Grand-Officier de la Légion d’honneur, Grand-Croix des ordres de Saint-Stanislas de Russie, de François-Joseph d’Autriche, de l’Aigle Rouge de Prusse, des S. S. Maurice et Lazare d’Italie, de Gustave Wasa de Suède, de la Conception de Portugal, du Mérite de Hesse, de Frédéric de Wurtemberg, du Nichan Iftikhar de Tunis, de la Rose du Brésil, du Medjidié de Turquie, de Saint-Michel de Bavière, Grand-Officier des ordres de Léopold de Belgique, de Guadalupe du Mexique, du Lion de Bade, et de Henri de Brunswick, Commandeur des ordres du Danebrog de Danemark, d’Albert de Saxe, de Saint-Grégoire-le-Grand, etc. etc.
Paris, juin 1882.
NOTE
[*] Extrait des Annales des mines, juillet-août 1882, p. 5-34.
Frédéric Le Play
1806-1882

Bibliographie générale
des ouvrages imprimés de Frédéric Le Play
Établie par Michel Prat et Antoine Savoye

Edmond Demolins
1852-1907
Henri de Tourville
1842-1903

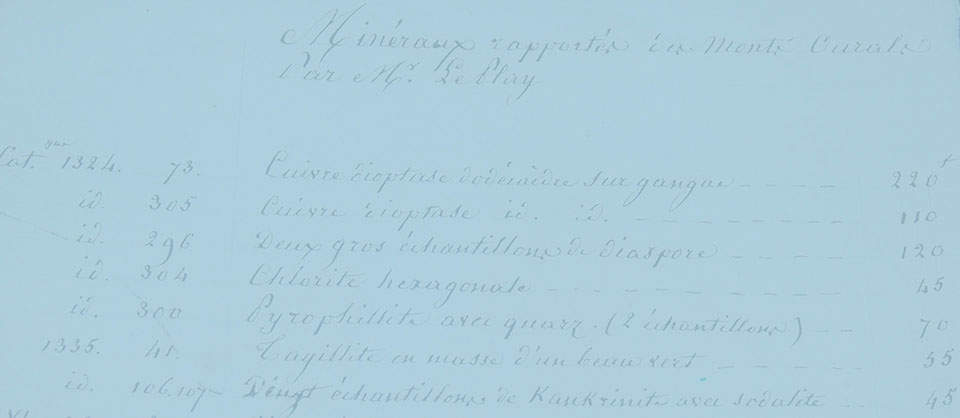
la sess
les études sociales
ressources
travaux ET ACTUALITÉS
nous suivre
liste de discussion
La société
© Serge Dandé 2025
© SESS 2025
Mentions légales et crédits
Newsletter
Les Ouvriers européens
Activités
Administrateurs
Groupes de travail
La bibliothèque
Le comité de rédaction
Les derniers numéros
Abonnez-vous
Achetez des numéros
La collection complète
Ligne éditoriale
Historique de la revue
Les Ouvriers des deux mondes
La Réforme sociale
Œuvres de Frédéric Le Play
Adhérer et soutenir la SESS
Nous contacter
Recherches en cours
Publications
Colloques, séminaires de recherche et journées d’études
Appels à contribution
Figures de la science sociale





